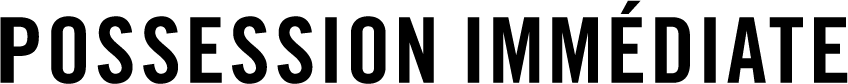texte paru dans Purple Fashion magazine n°24 (fall winter 2015 / 2016)
Je réalise aujourd’hui que ma fascination pour les drones s’était substituée – sans que je ne le réalisasse avant – à ma fascination pour les animaux et les documentaires animaliers regardés tout au long de ma vie en état de quasi hypnose. Je le réalise en lisant Le Versant animal de Jean-Christophe Bailly et en observant cette image de presse tristement célèbre de l’un des derniers rhinocéros blanc du Zimbabwe. L’animal, dans une sorte de soubresaut de conscience de la part des hommes, est dorénavant protégé vingt-quatre heures sur vingt-quatre par quatre militaires afin qu’on ne vienne pas le tuer pour voler sa corne. À l’instant où je réalise cela, tout s’entremêle : prédation, proies, guerres, anéantissements, altérité, enfance, ouverture et pure présence. Parce que l’animal est tout ça et bien plus.
Ce qui est en jeu est l’immédiateté du vivant à lui-même. Ce qui est en jeu est aussi un rapport au monde et à sa sensation que l’on nous escamote. Parce que ce rapport à la sensation animale n’a aucune valeur d’usage et d’échange, encore moins de valeur ustensilaire. L’animal nous conduit dans un « hors-notre-monde » tel que nous l’avons bâti et pensé.
L’homme est aujourd’hui pauvre en monde comme Heidegger avait tenté de dire que « l’animal était pauvre en monde ». L’être humain (occidentalisé) n’est plus capable d’écouter ni de voir. La tragédie se joue ici comme un impensé et même si toute une littérature alerte de la situation, elle n’est qu’un dérisoire sémaphore quant à l’état d’urgence présent.
Au moment même ou penseurs et scientifiques tirent en vain la sonnette d’alarme pour nous prévenir, chiffres à l’appui, de la disparition massive des espèces animales, nos yeux restent indifférents. Il est urgent de nous ressaisir de notre pensée mais aussi de la pensivité de l’animal et d’unir dans une sorte de sensation commune nos respirations.
Nous devrions comprendre que le monde est traversé par toutes les intelligences : ne se soucier que de la nôtre, c’est vivre en regardant par le bout de la lorgnette. C’est appauvrir les choses. C’est comprendre aussi pourquoi l’homme dévaste les mers, la terre, le langage. Il y a une poétique de l’habitation animale sur la terre. L’observer c’est déjà pister des traces de pensée.
Merleau-Ponty pense chaque animal comme une contraction précise de l’espace-temps. Je pense à la phrase de Bataille : « L’acte sexuel est dans le temps ce que le tigre est dans l’espace. »
Il n’y a pas d’exclusivité humaine du sens, nous dit Bailly : l’animal et son apparence sont à comprendre entièrement comme un langage, il n’y pas d’exclusivité humaine de l’intelligence.
Nous le savons, les animaux ont des émotions. Qu’il s’agisse de l’animal sauvage ou de compagnie : de sa joie, de ce rire dont il est capable, de l’éléphante pleurant son petit abattu par le braconnier, ou de la vache apeurée que l’on mène à l’abattoir, ces émotions sont peut-être infra ou extra humaine mais le problème n’est pas là : elles existent. Nous refoulons ou nions ces phénomènes par confort. Ils nous obligeraient à révolutionner notre pensée de fond en comble et de cela nous n’en avons pas envie. Il n’y a guère que les enfants capables aujourd’hui de se réjouir du prodige animal et de son existence.
La puissance de manifestation de l’existence animale, nous la côtoyons chaque jour. La ressentir ou la reconnaître est essentiel. Le raffinement de la pensée – son avalanche et son abandon que peut provoquer le surgissement animal – doit traverser cette sensation.
Face à la bête, la pensée glisse toute seule devant ce qu’elle voit, qui est alors ce qu’elle a cessé de rapporter à une conduite ou à une fin, nous dit Jean-Christophe Bailly.
Les mots « biodiversité » et « environnement » sont inadéquats car ils nient dans leur empaquetage la somme des singularités vivantes. Ces mots prolongent l’idéologie prétentieuse de l’homme à se mettre au sommet de la création. Tout cela ne veut plus rien dire.
Contre cette hiérarchie, il y a là une a-narchie à penser. Pour éviter la dévastation, il est grand temps de prendre en compte le destin animal.
Bailly toujours : « L’animal évadé de sa condition d’objet de la pensée, devient lui-même pensée, non en tant qu’il pense ou penserait (finalement on s’en fout !) Mais parce qu’il est. »
Au lieu de ça, nous célébrons les animaux en les modifiant génétiquement comme s’ils n’étaient que pure matière ou bien par une appropriation mimétique de la geste animale en faveur de la technique : il est troublant de voir pulluler ces projets de drones guerriers terrestres ressemblant à des chiens, des serpents ou des insectes. Au moment même où certains d’entre nous constatent la disparition massive des animaux, l’homme se constitue un bestiaire guerrier et potentiellement létal. Se détruire par des ersatz d’animaux : si il y a là une allégorie, elle ne peut être, au sens propre, que maléfique et cynique.
Nous avons réduit l’animal à une contraction, qu’elle soit technique, scientifique, guerrière ou alimentaire, nous ne l’envisageons plus que sous le prisme de la réduction ; niant sa puissance de déploiement, son surgissement, son altérité et sa poétique d’existence.
L’anthropocentrisme rayonnant, technique et post industriel se moque bien entendu de ces impressions-là. Elles ne rapportent rien.
John Jefferson Selve